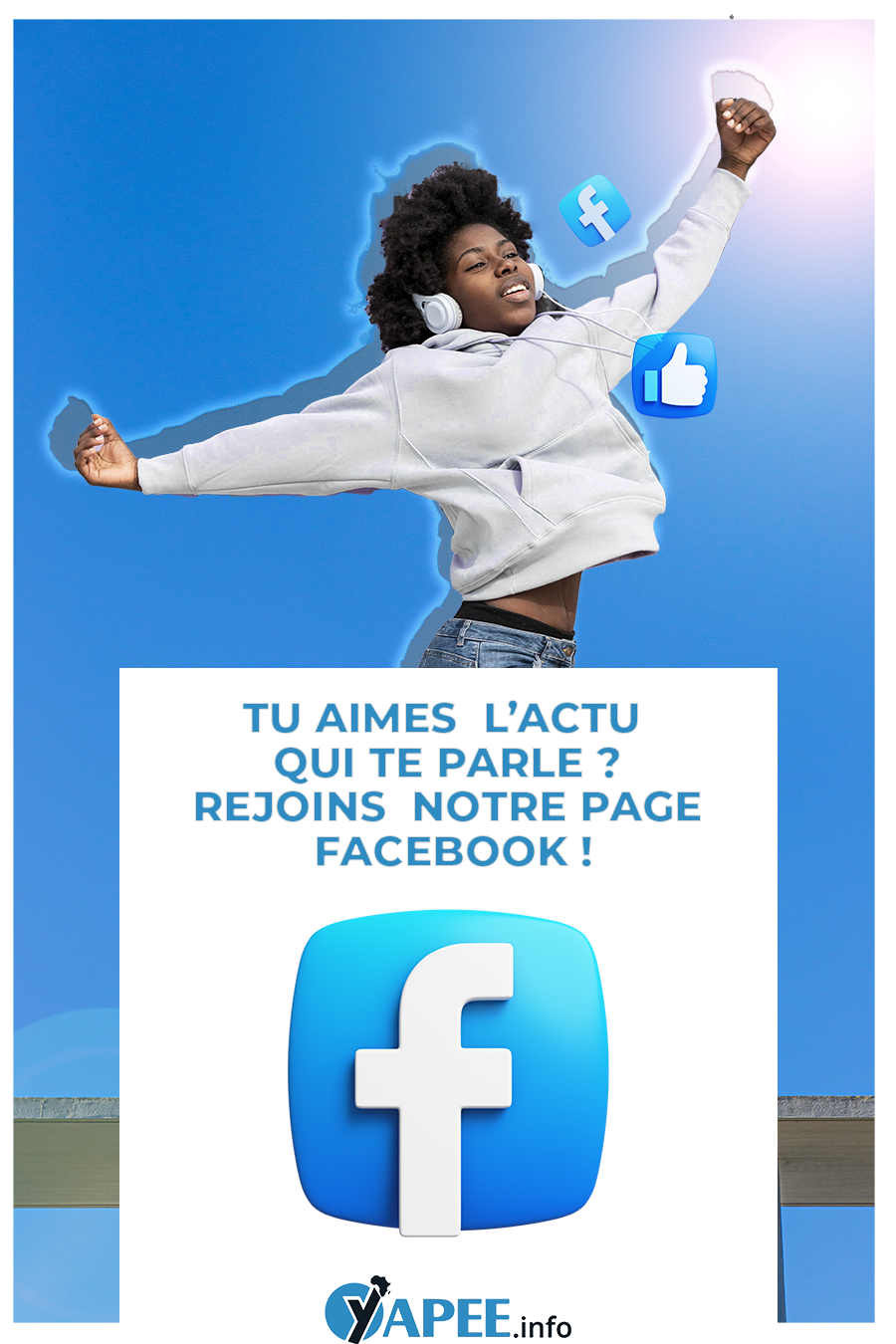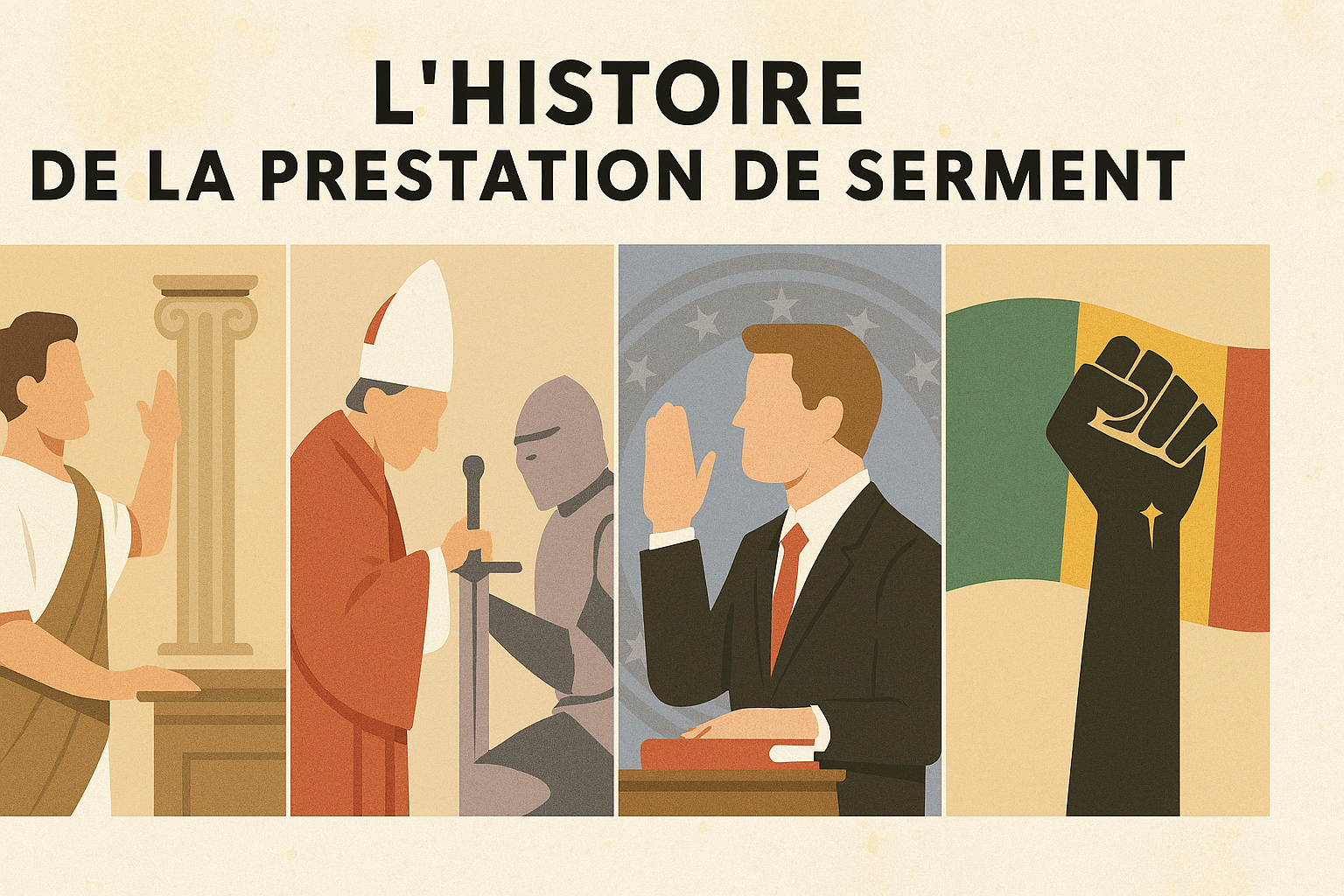
Histoire et portée politique de la prestation de serment : entre rituel républicain et outil de contestation.
La prestation de serment est un acte solennel et universel qui traverse les âges et les régimes politiques. Elle incarne l'engagement public d'un individu envers une fonction, une loi ou une communauté, et s'inscrit dans une tradition à la fois juridique, morale et symbolique. Son origine remonte à l'Antiquité, où les Grecs et les Romains juraient devant les dieux pour garantir leur loyauté, leur vérité ou leur fidélité. Ce serment, souvent religieux, servait à sceller des alliances, à valider des témoignages ou à légitimer l'exercice du pouvoir.
Au fil des siècles, la prestation de serment a évolué. Au Moyen Âge, elle devient un instrument féodal : les vassaux prêtsent serment à leurs seigneurs, les chevaliers à leurs ordres, les membres des guildes à leurs corporations. Ce lien d'obéissance et de loyauté se transforme progressivement, avec l'émergence des États modernes, en un engagement républicain. Dans les régimes constitutionnels contemporains, le serment est codifié dans les textes fondamentaux. Il marque l'entrée en fonction des chefs d'État, des ministres, des juges ou des parlementaires, et symbolise la transparence, la responsabilité et la souveraineté populaire.
La prestation de serment possède une double nature. D'un point de vue juridique, elle est souvent exigée par la loi comme condition préalable à l'exercice d'une fonction. Elle engage la responsabilité de celui qui la prononce et peut, en cas de violation, entraîner des sanctions. D'un point de vue symbolique, elle incarne une promesse publique, un pacte moral entre le représentant et la nation. Elle est souvent prononcée devant une assemblée, retransmise en direct, et accompagnée de gestes forts : main levée, main sur la Constitution, invocation de Dieu ou de la République.
Dans les États africains post-indépendance, la prestation de serment a été intégrée aux Constitutions comme un rituel d'État. Elle sert à affirmer la souveraineté nationale, à structurer les institutions et à légitimer le pouvoir. Au Cameroun, elle est prévue par l'article 7 de la Constitution et se déroule traditionnellement devant l'Assemblée nationale, en présence du Conseil constitutionnel et des corps constitués.
Cependant, l'actualité politique camerounaise de novembre 2025 révèle une situation inédite. Alors que le président Paul Biya s'apprête à prêter serment pour entamer un nouveau mandat, une autre prestation de serment est annoncée, celle d'Issa Tchiroma Bakary. Cette initiative, contestataire et non reconnue par les institutions officielles, vise à revendiquer une légitimité populaire face à ce que son auteur est qualifié de confiscation électorale. Issa Tchiroma entend prêter serment devant la Constitution camerounaise, dans un geste hautement symbolique, destiné à marquer une rupture avec l'ordre établi.
Cela semble parallèle, bien qu'invalide juridiquement, s'inscrit dans une stratégie politique de rupture. Il cherche à interpeller la communauté internationale, notamment la Cour pénale internationale, sur les dérives du régime en place. Il vise également à mobiliser la société civile autour d'un contre-pouvoir symbolique, fondé sur la souveraineté populaire. Depuis l'annonce de cette initiative, plusieurs villes ont observé des journées de « villes mortes », avec marchés fermés, transports à l'arrêt et rues désertées. Pour Issa Tchiroma, cette mobilisation silencieuse est la preuve que le peuple n'a pas voté pour la peur, mais pour le changement.
La prestation de sement contestataire soulève une question fondamentale : peut-on être légitime sans être légal ? Le serment officiel, encadré par la Constitution et validé par le Conseil constitutionnel, incarne la légalité institutionnelle. Le serment parallèle, fondé sur la mobilisation citoyenne et les principes universels de démocratie, revendique une légitimité populaire. Ce dilemme rappelle d'autres cas africains, comme celui de Raila Odinga au Kenya en 2018, qui avait prêté serment comme « président du peuple » sans reconnaissance institutionnelle.
La coexistence de deux sentiments au Cameroun révèle une crise de confiance dans les institutions et une volonté de réinvention démocratique. Elle pose plusieurs défis majeurs : comment garantir la transparence électorale et la légitimité des mandats ? Quelle place accorder aux formes alternatives de contestation dans l'espace public ? Comment articuler la résistance pacifique et la construction institutionnelle ? Ces questions, au cœur de l'actualité camerounaise, résonnent bien au-delà des frontières nationales.
En définitive, la prestation de service, qu'elle soit officielle ou contestataire, reste un outil puissant de communication politique. Elle incarne une parole publique, un engagement solennel, une vision du pouvoir. Dans un contexte de tensions post-électorales, elle devient un champ de bataille symbolique entre légalité et légitimité, entre institutions et peuple, entre continuité et rupture.
Gontran Eloundou
Analyste Politique
+237 673 933 132
- Créé le .
- Vues : 368