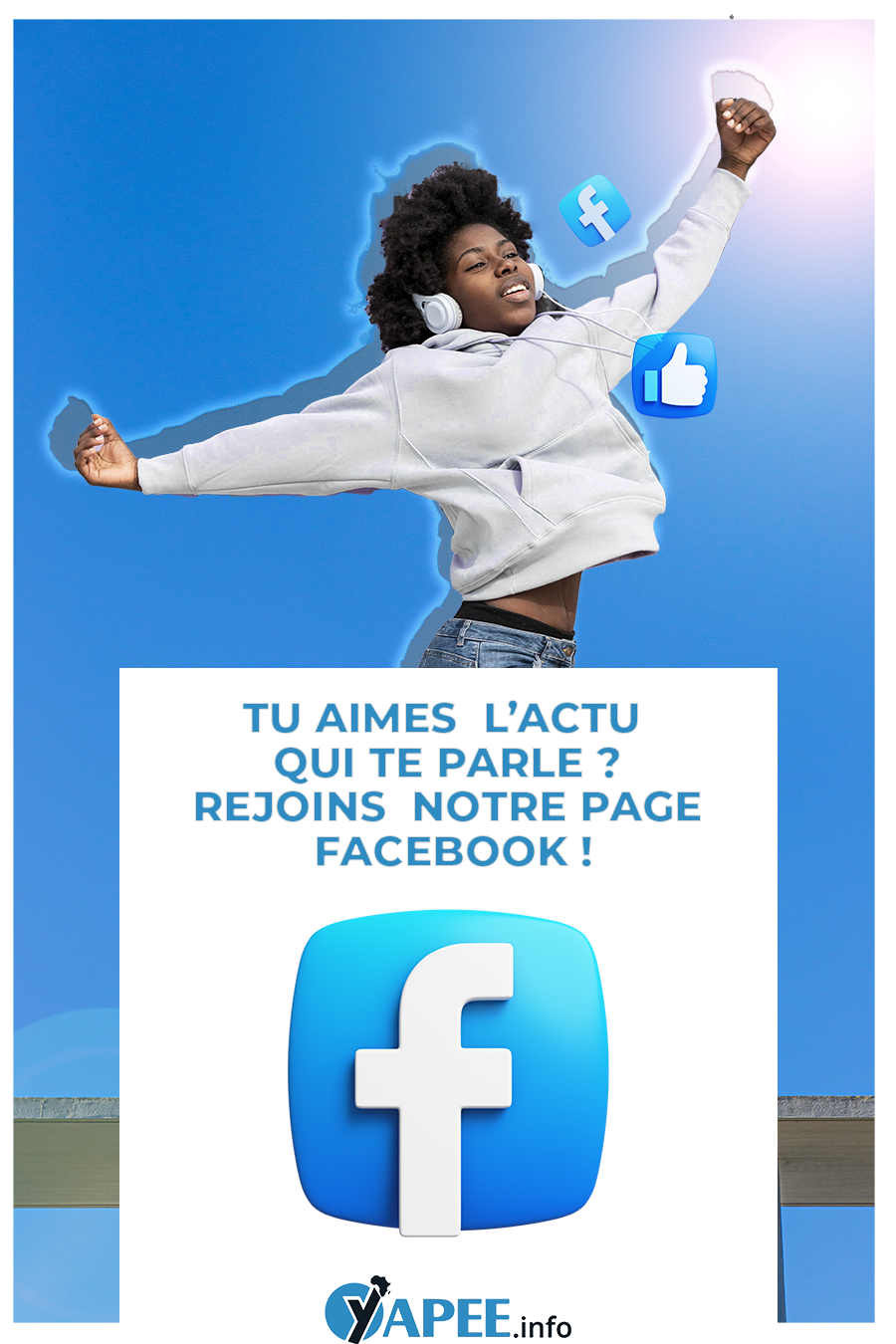Paul Biya, l'an 43: une lecture de la longévité politique et de la trajectoire économique d’un régime.
Le 6 novembre 2025, Paul Biya prêtera une nouvelle fois serment à la tête de l'État camerounais, exactement 43 ans après son accession au pouvoir en 1982. Ce moment hautement symbolique, coïncidant avec un climat post-électoral tendu, constitue une opportunité analytique pour interroger la nature, les dynamiques et les effets d'un régime politique dont la longévité défie les normes démocratiques contemporaines. Loin d'un simple inventaire, cette analyse s'inscrit dans une perspective critique, mobilisant les outils de la science politique et de l'économie politique pour évaluer les transformations institutionnelles, les performances macroéconomiques, les mutations sociales et les enjeux de gouvernance qui ont jalonné les quatre décennies du régime Biya.
Dès son arrivée au pouvoir, Paul Biya s'est inscrit dans une logique de continuité institutionnelle avec le régime de son prédécesseur, Ahmadou Ahidjo, tout en amorçant une recentralisation lente mais progressive du pouvoir autour de sa personne. Le passage au multipartisme en 1990, sous la pression des mouvements sociaux et des bailleurs internationaux, n'a pas fondamentalement modifié les rapports de force politiques. Le système électoral, bien que formellement pluraliste, est dominé par le Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais (RDPC), parti présidentiel hégémonique, qui a su instrumentaliser les institutions électorales, les ressources publiques et les réseaux clientélistes pour maintenir son emprise sur l'appareil d'État. Les révisions constitutionnelles successives, notamment celle de 2008 supprimant la limitation des mandats présidentiels, ont renforcé un hyperprésidentialisme déjà solidement ancré, consolidant un régime qualifié par de nombreux analystes de « néo-patrimonial ».
Sur le plan de la gouvernance, le régime Biya se caractérise par une forte centralisation décisionnelle, une faible redevabilité institutionnelle et une extrême personnalisation du pouvoir. La longévité du président s'accompagne d'une stabilité apparente, souvent présentée comme un gage de paix dans une région en proie à l'instabilité. Toutefois, cette stabilité s'est construite au prix d'un verrouillage de l'espace civique, d'un affaiblissement des contre-pouvoirs et d'une répression récurrente des mouvements sociaux et politiques. Les crises majeures, telles que le conflit armé dans les régions anglophones depuis 2016, les tensions récurrentes dans l'Extrême-Nord face à Boko Haram, ou encore les contestations post-électorales de 2018 et 2025, ont révélé les limites d'un modèle de gouvernance fondé sur la coercition plutôt que sur l'inclusion.
Sur le plan économique, le Cameroun sous Paul Biya a connu une croissance modérée mais structurellement fragile. Malgré des ressources naturelles abondantes – pétrole, gaz, bois, cacao – l'économie reste peu diversifiée, fortement dépendante des exportations de matières premières et vulnérable aux chocs exogènes. Les politiques de développement, telles que le Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE) ou la Stratégie Nationale de Développement 2020-2030 (SND30), ont affiché des ambitions d'émergence économique, mais leur mise en œuvre a été entravée par des déficits de gouvernance, une faible capacité administrative et une corruption endémique. Le secteur industriel demeure embryonnaire, avec une transformation locale des produits primaires quasi inexistante, tandis que le secteur informel absorbe une grande partie de la main-d'œuvre, souvent dans des conditions précaires.
Les indicateurs de développement humain traduisent cette stagnation : l'indice de développement humain (IDH) reste moyen, les inégalités sociales et régionales persistantes, et l'accès aux services de base demeure inégale. Le taux de pauvreté, bien qu'en légère baisse, touche encore un quart de la population, avec des poches de vulnérabilité aiguë dans les zones rurales et périphériques. L'éducation et la santé, bien que prioritaires dans les discours officiels, souffrent d'un sous-financement chronique et d'une gouvernance inefficace.
Enfin, la diplomatie camerounaise sous Paul Biya s'est caractérisée par une prudence stratégique, un alignement pragmatique sur les grandes puissances (France, Chine, États-Unis) et une participation active aux organisations régionales et internationales. Toutefois, cette diplomatie n'a pas toujours été mobilisée pour résoudre les crises internes, notamment le conflit anglophone, où les appels au dialogue ont souvent été relégués au second plan.
En somme, le bilan des 43 ans de pouvoir de Paul Biya révèle un paradoxe : celui d'un régime politiquement résilient mais économiquement stagnant, institutionnellement stable mais démocratiquement verrouillé. Alors que le Cameroun entre dans une nouvelle phase de son histoire politique, marquée par des incertitudes générationnelles et des aspirations citoyennes renouvelées, la question de la transition politique, de la refondation institutionnelle et de la justice sociale demeure plus que jamais centrale.
Gontran Eloundou
Analyste politique
+237 673 933 132
Prestation de serment, que va dire Paul Biya face à la crise post électorale
- Créé le .
- Vues : 394