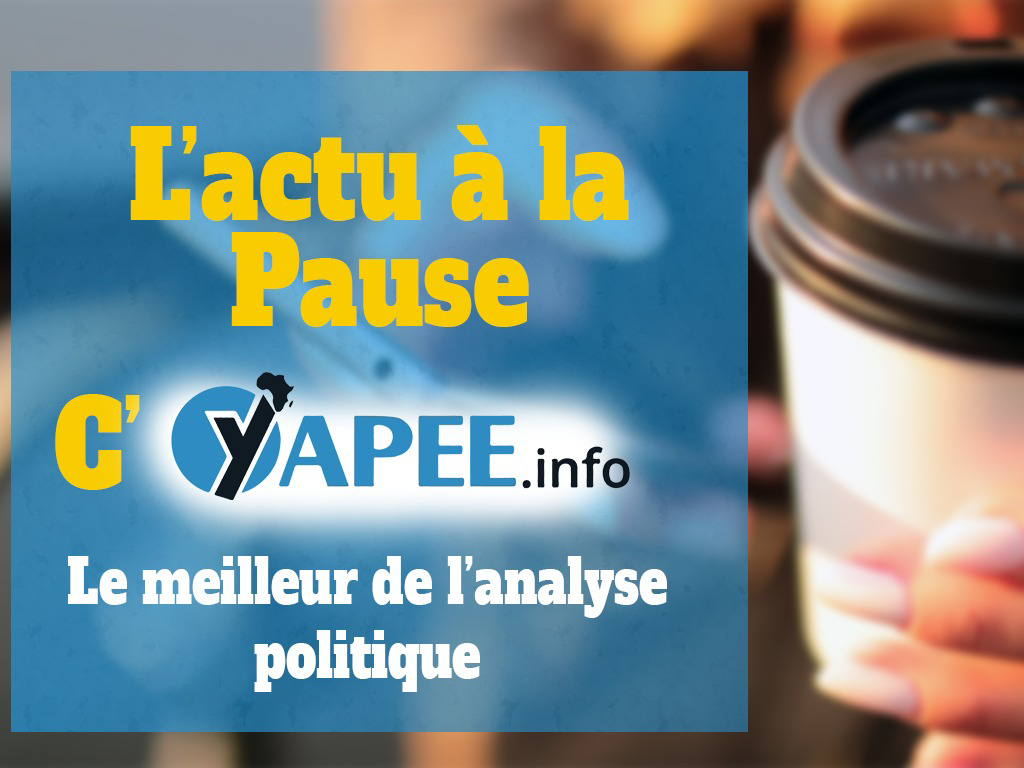Le Cameroun au ralenti : l’Union pour le Changement tente une démonstration de force
Le 23 octobre 2025, le mouvement politique Union pour le Changement a lancé un appel à une mobilisation nationale sous forme de ville morte, invitant les citoyens à rester chez eux de 6h à 18h. Cette action symbolique visait à célébrer la victoire présumée de son candidat Issa Tchiroma à la présidentielle 2025, tout en exerçant une pression politique sur le Conseil constitutionnel, chargé de proclamer les résultats définitifs. Dans un climat post-électoral tendu, cette initiative marque une tentative de l’opposition de reprendre la main sur le récit démocratique.
L’appel à la ville morte s’inscrit dans un contexte de contentieux électoral marqué par le rejet des recours déposés par plusieurs partis d’opposition. Alors que les résultats provisoires donnent l’avantage au candidat du pouvoir, l’Union pour le Changement conteste la régularité du scrutin et dénonce des « irrégularités massives ». En l’absence de recours institutionnels efficaces, le mouvement choisit la rue — ou plutôt le silence des rues — comme levier de contestation et de mobilisation citoyenne.
Ce type d’action, bien que non violent, repose sur une stratégie de désobéissance civile passive. En appelant les citoyens à suspendre leurs activités, à ne pas se rendre au travail ni dans les commerces, l’Union pour le Changement cherche à créer un effet de paralysie visible, médiatisable et politiquement significatif. Le mot d’ordre est clair : faire entendre la « volonté des urnes » par le vide, en transformant l’espace public en symbole de mécontentement.
Mais les chances de succès d’une telle mobilisation restent incertaines. D’une part, la capacité de l’opposition à fédérer au-delà de ses bastions traditionnels est limitée. D’autre part, le climat de peur, les restrictions numériques (ralentissement d’Internet, coupures téléphoniques), et l’absence de relais médiatiques indépendants compliquent la diffusion du mot d’ordre. Dans plusieurs villes, les témoignages font état d’une circulation normale et d’une faible adhésion populaire, malgré une forte présence sur les réseaux sociaux.
La figure d’Issa Tchiroma, longtemps perçue comme un acteur controversé du paysage politique camerounais, joue ici un rôle central. Sa candidature, bien que inattendue, a su capter une partie de l’électorat en quête de rupture. L’appel à la ville morte devient ainsi un outil de légitimation symbolique, visant à inscrire son nom dans l’histoire électorale, même en l’absence de reconnaissance institutionnelle.
Du côté du Conseil constitutionnel, le rejet des recours et le maintien du calendrier de proclamation des résultats renforcent l’idée d’un processus verrouillé. L’institution, censée incarner la neutralité juridique, est accusée par certains acteurs de manquer de transparence. Cette perception alimente la défiance et justifie, aux yeux de l’Union pour le Changement, le recours à des formes alternatives de contestation.
Sur le plan stratégique, l’appel à une ville morte peut être vu comme un test de mobilisation citoyenne en période post-électorale. Il permet à l’opposition de mesurer son influence réelle, de capter l’attention internationale, et de poser les bases d’une éventuelle coalition pour les législatives à venir. Toutefois, sans relais institutionnels solides ni couverture médiatique indépendante, l’impact reste limité à l’effet d’annonce.
En définitive, cette journée de ville morte révèle les fragilités démocratiques du Cameroun, où la rue devient parfois le dernier espace d’expression politique. Elle interroge sur la capacité des institutions à garantir la légitimité électorale, et sur le rôle des citoyens dans la défense de leur souveraineté. Si l’Union pour le Changement n’a pas paralysé le pays, elle a néanmoins posé un acte politique fort, qui pourrait marquer les esprits au-delà du scrutin.
Gontran Eloundou
Analyste politique.

- Vues : 393